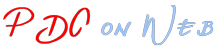Commencée avec le mouvement #PayeTonAuteur, la crise des auteurs (scénaristes de films, de séries, de BD, dessinateurs, romanciers, essayistes, etc.), n'a cessé de croitre. Le malaise, le mal être, est de plus en plus palpable et les auteurs de plus pessimistes. Décryptage.
Depuis plusieurs semaines, le monde des auteurs connaît des soubresauts dont l’épicentre se trouve dans le milieu de la BD.
Manifestations dans les festivals, tribunes, réunions de concertation, scandale de l’AGESSA, puis, enfin, rapport Racine. Telles sont les séquences qui ont mené, logiquement, à un dénouement combien prévisible : les préconisations du Ministre de la Culture, Franck Riester.
Un dossier de 10 pages, écrit gros, avec une marge à gauche de 12 bons centimètres... bref, rien qu’en le survolant, on sent le vide à plein nez. Et quand on le lit, on n’est pas déçu : c’est bien complètement vide.
Et c’est normal ! Il ne pouvait en être autrement, sauf à remettre intégralement en cause la notion même des Droits d’Auteur, celle sur laquelle repose tout l’exception culturelle.
Le droit d’auteur actuel
Le droit d’auteur tel que nous le connaissons en France trouve ses prémisses lors des lois de 1791 à 1793. La Révolution Française abolit alors les privilèges et accorde aux auteurs le monopole de l’exploitation sur la représentation de leurs œuvres.
L’idée fondamentale est alors posée : l’auteur tire ses ressources des revenus dégagés par l’exploitation de son œuvre, autrement dit de son succès.
La loi du 11 mars 1957 va affiner ce concept en distinguant droits moraux (indissociables) et droits patrimoniaux (cessibles), mais sans revenir sur le principe premier : les revenus de l’auteur sont proportionnels aux bénéfices générés par l’exploitation de ses œuvres.
Seulement voilà : depuis, le monde a changé. Pire, il a été complètement chamboulé.
“Aujourd’hui, il est structurellement impossible de vivre de ses Droits d’Auteur.”
Dans les faits, comment ça marche ?
Un auteur, qu’il soit scénariste (de BD, de films, de séries, de documentaires) ou auteur d’un livre (romancier, essayiste, dessinateur de BD...), va céder ses droits d’auteurs (patrimoniaux) à un producteur ou un éditeur pour une période donnée (cet élément est très important !). Le producteur ou l’éditeur devient ainsi l’ayant droit de l’œuvre, celui qui en détient les droits d’exploitation. L’ayant droit va donc exploiter l’œuvre et l’auteur, conformément au principe révolutionnaire de 1791, touchera un revenu proportionnel à l’argent généré par l’exploitation de son œuvre.
Un beau principe sur le papier, mais devenu complètement caduque avec le temps.
Pourquoi ?
Parce qu’aujourd’hui – et contrairement aux moments où ces lois ont été faites – l’offre a submergé la demande. Vous-mêmes qui me lisez (merci pour cela), avez-vous le temps de voir, de lire, d’écouter, de jouer à toutes les œuvres qui vous intéressent ? Bien sûr que non (ou alors, envoyez-moi votre méthode par mail, svp !). Et pourtant, ces œuvres qui vous attirent ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’offre disponible !
Tant que l’on était dans la situation inverse, l’exploitation d’une œuvre rencontrait un public suffisant pour générer des revenus pour l’auteur. Maintenant que l’on a dépassé le point d’équilibre et que les courbes se sont croisées, c’est tout le contraire !
Et la chute est vertigineuse ! Quasiment plus aucune œuvre (exceptions faites des blockbusters qui dépensent des sommes astronomiques en marketing) n’arrivent à engendrer plus que quelques miettes.
C’est pour cela, qu’aujourd’hui, il est structurellement impossible de vivre de ses Droits d’Auteur.
Alors, hélas oui, les auteurs peuvent toujours réclamer 10% minimum de droit d’auteur, 12 % même ou 15 s’ils veulent : X% de presque rien ne fera jamais grand chose. Ce combat là est, hélas, dans l’état actuel des choses, vain.
Minimum Garanti, à-valoir et autres avances sur droits d’auteur.
Pour beaucoup de personnes, l’auteur vend son scénario. C’est d’ailleurs une expression commune qu’emploie même les auteurs : « maintenant que c’est écrit, il ne me reste plus qu’à le vendre ».
Évidemment, l’expression est abusive. L’auteur, on l’a vu plus haut, ne vend pas son scénario : il en cède les droits d’exploitation pour une période donnée. Le sacro-saint principe du Droit d’auteur, inviolable et incontestable.
Alors pourquoi touche-t-il une somme quand il signe chez un éditeur ou un producteur ?
Tout d’abord, il faut être clair : pour ne pas contrevenir au principe de la rémunération de l’auteur sur l’exploitation de son œuvre, cette somme d’argent (Minimum Garanti ou à-valoir en fonction des domaines d’activité) est une avance faite par le nouvel ayant-droit sur les futurs revenus de l’auteur. Le producteur ou l’éditeur se la remboursera donc sur la part revenant à l’auteur et ne lui versera donc les revenus proportionnels à l’exploitation de l’œuvre qu’une fois intégralement rentré dans ses fonds. Alors, évidemment, dans un contexte où les œuvres se vendent peu, il est logique que cette avance ne soit pas forcément conséquente : feriez-vous, vous, une avance importante en sachant que vous avez aucune chance de la récupérer ?
Mais, ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que cette avance n’est nullement obligatoire ! Et, là encore, c’est parfaitement logique. Rappelez-vous, principe premier : l’auteur tire ses revenus de l’exploitation de son œuvre. Et de rien d’autre.
Pas d’exploitation, pas de sous. Pas de bras, pas de chocolat.
En réalité, cette avance sert à fidéliser les auteurs à succès, afin de s’assurer de produire ou d’éditer leurs prochaines œuvres.
Vous êtes un auteur débutant, peu connu, vendant peu ? Pourquoi un producteur ou un éditeur vous verserait une avance qu’il n’arrivera pas à se rembourser ?
Je vous entends déjà répondre : parce que c’est à lui de prendre le risque. Ah bon ? Et de quelle autorité peut-on affirmer une telle chose ?
Son devoir, c’est d’exploiter au mieux l’œuvre ; sa responsabilité, c’est de faire tourner son entreprise (comme n’importe quel chef d’entreprise). Pas d’être un mécène pour des auteurs. Là, on retournerait à la situation d’avant la Révolution Française. Impossible donc.
D’ailleurs la très grande majorité des gérants de petites structures de production ou d’édition rencontrent les mêmes difficultés financières que les auteurs. Opposer l’un à l’autre n’a de sens que lors que l’on parle des grosses structures et des auteurs qui arrivent à vivre (plus ou moins bien) de leur travail. C'est un autre débat, même si certains de ces derniers essayent de profiter de la situation désastreuse actuelle de l'ensemble des auteurs pour s'assurer de leur survie... Regrettable, déplorable, mais pourtant, ne soyons pas naïf, inévitable.
Mais revenons à aujourd’hui, avec une offre qui dépasse très largement la demande. La conséquence logique, c’est que le volume d’argent dépensé pour ces loisirs culturels se répartit sur bien plus d’œuvres, s’émiette. On en revient ainsi toujours au même : dans ce contexte, comment un producteur ou un éditeur pourrait faire une avance à un auteur alors qu’il est certain de ne pas pouvoir se la rembourser ?
“Barrer de quelques degrés à tribord n’a pas sauvé le Titanic du naufrage...”
Iceberg droit devant !
Résumons. Il est impossible d’imposer un montant minimum à une avance qui n’est pas obligatoire. De même, les remontées des Droits D’auteur étant tellement insignifiantes, que les auteurs de l’écrasante majorité des œuvres produites ou éditées ne toucheraient que quelques centimes de plus que dans la situation actuelle, si leurs droits augmentaient de 1 ou 2 points. Sauf pour les quelques-uns qui parviennent déjà à vendre suffisamment pour permettre le remboursement de leur avance, là le sujet prend sens. Mais cette crise doit-elle améliorer les conditions de TOUS les auteurs ou est-elle instrumentalisée par ceux qui surnagent déjà pour renforcer leurs acquis ? Il convient de se poser la question.
Bref, on aura beau discuter, tergiverser, argumenter, tant que le Droit d’Auteur n’évoluera pas en profondeur, restera sur le sacro-saint principe de la rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’offre comme unique source de revenu pour les auteurs, ceux-ci ne pourront que s’appauvrir. Toute avancée sera, en réalité, cosmétique et éphémère : barrer de quelques degrés à tribord n’a pas sauvé le Titanic du naufrage...
Produire moins : la solution illusoire.
On l’entend souvent : puisque nous sommes dans une phase de surproduction, il convient de réduire les volumes pour résoudre le problème. Logique. D’autant plus que le marché de la BD a toujours connu ce cycle sinusoïdal qui s’étend, habituellement, sur environ 5 ans.
Mais là, le problème concerne tous les auteurs et dépasse amplement le microcosme de la bande dessinée.
Toutefois, le principal élément qui rend cette stratégique caduque est ailleurs. La plus grande partie de la surproduction dont on parle provient des amateurs : auto-entrepreneur, auto-édition, association qui essayent de se comporter comme des sociétés, etc.
Avec la démocratisation des outils de production, tout le monde peut actuellement se prétendre auteur. Tout le monde sait faire des films parce que tout le monde peut posséder le dernier photocam de la mort qui tue 442 HQ+, tout le monde peut pirater adobe première, tout le monde peut écrire des mots sur un traitement de texte et, enfin, tout le monde met son œuvre sur Amazon ou ailleurs.
Résultat : un tsunami de propositions qui nous noie, nous submerge, nous empêche de distinguer l’amateur du professionnel, et in fine, souvent, nous déçoit.
Mais le pire, c’est que sur tout ce pan, les professionnels n’ont aucun contrôle !
Ils peuvent baisser leur production autant qu’ils le souhaitent : le volume global de l’offre ne variera pas d’un iota, la côte part des œuvres professionnelles ne faisant guère le poids face à celle des amateurs, sans cesse grandissante.
“Des solutions existent, sûrement, mais elles imposent un changement total de paradigme.”
Alors oui, la conclusion ne peut qu’être pessimiste : en l’état, il n’y a aucune solution qui permettraient d’assurer un revenu décent aux auteurs. Plus de nos jours.
La mutation profonde du contexte rend le modèle dépassé, périmé.
Des solutions existent, sûrement, mais elles imposent un large changement de paradigme.
C’est pour cela que les conclusions du Ministre ne pouvait être que décevantes : en s’inscrivant dans le système actuel, en ne focalisant que sur les éléments périphériques (rémunération des auteurs en dédicace – bien, mais quid des scénaristes qui ne dédicacent pas ? – professionnalisation des auteurs – ça veut dire quoi ? Que se sont actuellement des amateurs ? Super. Retour à la case départ. Ça les fera mieux vivre ? – augmentation de leur pourcentage – même avec 20% de presque 0, ils ne vont pas aller loin...), il n’y a aucune issue possible.
Alors, est-ce à dire que le métier de scénariste est mort ?
Non, bien sûr. Mais il est urgent et indispensable de le faire évoluer.
Comment ?
Ça, on en parle dans le prochain article (c’est déjà bien que vous ayez tenu jusque là !).
PDC.